News

La Défense Aérienne et AntiMissile Intégrée (IAMD) en Europe : complexité OU consensus ?
La défense aérienne et la défense antimissile balistique font l’objet de programmes et de débats au sein de l’OTAN depuis plus de 10 ans. Elles suscitent régulièrement des ajustements du fait de l’évolution du contexte stratégique et des menaces. La réalité des menaces aériennes et des missiles balistiques courte portée est aujourd’hui incontestable sur les zones extérieures à l’Europe mais néanmoins aux portes des territoires de l’OTAN. Elle devrait faire consensus. Alors que l’OTAN dispose de systèmes de commandement de défense aérienne qui peuvent être étendus à la défense antimissile, la recherche d’un consensus sur la défense aérienne et antimissile intégrée semble probable. Il est atteignable s’il on trouve des contributions équilibrées et mesurées entre les USA et l’Europe, avec une participation de l’industrie européenne à des programmes pour lesquels l’Europe a déjà investi. Dans un contexte de rigueur budgétaire mais aussi de risques sécuritaires, l’industrie transatlantique et européenne peut et doit apporter des solutions pour l’évolution des systèmes de commandement et l’interopérabilité renforcée des systèmes de défense.
Par exemple, des concepts de mise en réseaux de senseurs et des systèmes d’armes pourraient être envisagés à moyen terme, comme un facteur d’amélioration de l’interopérabilité entre les systèmes mais aussi de coopération entre les industries.
Une perception des menaces et des priorités nuancée entre défense de théâtre et de territoire
Face à la généralisation des menaces aériennes et missiles les Européens doivent mettre de côté leurs différences afin de trouver un consensus sur une défense aérienne et antimissile intégrée (ou IAMD)1 tout en préservant la souveraineté des espaces aériens et des territoires nationaux. En parallèle, le Commandement et le Contrôle de la composante aérienne de l’OTAN permet la conduite d’opérations aériennes coordonnées en s’interfaçant avec les systèmes de contrôle aériens nationaux (ARS).
Comment se défendre face à ce qu’on appelle les menaces «à propulsion aérobie ou Air-Breathing » ainsi que les menaces balistiques, qui forment ensemble ce qu’on appelle dans le jargon « Missile Defense », la menace duale ? Avec une défense IAMD ou une simple défense antimissile balistique ? Par ailleurs, comment préserver voire renforcer l’équilibre des contributions collectives et nationales à l’OTAN et le rôle joué par l’industrie européenne, tout en faisant face aux pressions budgétaires qui pèsent sur les budgets de défense en Europe notamment ? Comment assurer un Commandement Intégré de l’OTAN avec un processus consultatif entre les nations pour la planification et les règles d’engagement des systèmes d’armes longue portée contre des menaces qui survoleraient le sol européen ? Autant de défis majeurs à relever!
Le développement de l’architecture de défense ALTBMD (Active Layered Theater Ballistic Missile Defence), de défense antimissile de théâtre de l’OTAN, a commencé progressivement en 2005, avec une première capacité opérationnelle de théâtre dite « INCA » pour Initial Capability qui fut déclarée opérationnelle en 2011, puis une capacité de défense du territoire intérimaire (iBMD), déclarée opérationnelle en 2012 (sommet de Chicago). Son objectif est l’intégration progressive d’une architecture de défense antimissile composée de plusieurs couches de défense (haute et basse altitude) pour protéger les troupes en opération ainsi que des sites d’importance vitale contre une menace duale sur les théâtres d’opérations extérieures. Cette menace duale est constituée par des missiles balistiques de portée intermédiaire (jusqu’à 3000 km de portée) et par des menaces aériennes « à propulsion aérobie » comme les missiles de croisière ou les avions de combat.
Toutefois, depuis le début des années 2000, des études de défense du territoire et des populations ont également été conduites par l’OTAN pour lutter contre une menace balistique proliférante émergente de type missile ICBM2, de longue portée. Bien qu’étant un objectif de prolifération et de développement potentiel dans certains pays, à partir des technologies de lanceurs spatiaux, cette menace ICBM n’était pas prioritaire vue de l’Europe, tandis qu’elle était considérée comme plus probable par les USA. Les USA ont donc déployé à cette fin un système de défense antimissile terrestre « GMDS » pour la contrer, basé en particulier sur les intercepteurs GBI longue portée, anti « ICBM » répartis sur deux sites américains. Sans consensus global, ni sur le spectre de menace, ni sur les priorités en terme de couverture et de budget, il n’y a pas eu la volonté d’investir dans un système de défense jugé très coûteux pour la défense antimissile « anti ICBM » du continent européen. Le projet de « 3ème Site antimissile en Europe », supposé compléter les deux sites d’intercepteurs américains, fut un exemple de cette différence d’appréciation des priorités sur les menaces et la façon de s’en protéger. Ainsi, le projet américain était presque uniquement focalisé sur la protection du continent américain par un troisième site avancé en Europe, tandis que la couverture de l’Europe restait partielle vis à vis des ICBMs, eux-mêmes considérés comme une menace non prioritaire d’abord par les européens, puis finalement par les USA. Le projet de 3ème site fut donc abandonné en 2009.
L’approche politique a donc radicalement changé avec le projet de défense régionale « European Phased Adaptive Approach » (EPAA) proposé par l’administration Obama. Ce fut un nouveau départ pour la coopération sur une défense antimissile en Europe basée sur la couche haute altitude de l’ALTBMD ; une synergie a alors paru possible entre les systèmes américains (Frégates Aegis dotées de missiles SM3 déclinées également en une version terrestre, l’Aegis « ashore », voir Figure 1), les centres de commandement de l’OTAN et américains, et les systèmes de défense aérienne et antimissile européens. L’EPAA a également confirmé le déploiement des systèmes américains de défense antimissile balistiques basés au sol combinant des systèmes haute altitude (Aegis ashore-missile SM3) et basse altitude duaux, comme les systèmes Patriot (voir Figure 2), américains, ou européens (Allemagne, Pays-Bas) ou les systèmes franco-italiens SAMP/T (voir Figure 3). En effet, il faut bien assurer une défense des sites contre des menaces plus conventionnelles ou balistiques courte portée qui viseraient les zones de l’Alliance les plus exposées.
Figure 1 : le système Aegis est un système de combat monté sur les destroyers américains qui permettent la mise en œuvre du missile SM3 exo-atmosphérique avec le radar de tir SPY1 (Figure 1.1). Ce système utilise aussi le radar AN-TPY2 (Figure 1.2), conçu comme radar de tir du système Thaad, qui est dédié à la mission antimissile balistique, mais aussi utilisé en mode radar d’alerte en position avancée (FBR), pour permettre une poursuite précoce des missiles balistiques et permettre un engagement au plus tôt du missile SM3, en mode « launch on remote » ou « engagement on remote » avant l’accrochage du SPY1 sur le missile assaillant.
[[{"fid":"2308","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Figure 1.1 (à gauche): radar SPY-1 du système Aegis ashore (à terre) qui opère en bande S. Figure 1.2 (à droite) : radar AN-TPY2 du système Thaad en bande X.","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Figure 1.1 (à gauche): radar SPY-1 du système Aegis ashore (à terre) qui opère en bande S. Figure 1.2 (à droite) : radar AN-TPY2 du système Thaad en bande X."},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Figure 1.1 (à gauche): radar SPY-1 du système Aegis ashore (à terre) qui opère en bande S. Figure 1.2 (à droite) : radar AN-TPY2 du système Thaad en bande X.","title":"Figure 1.1 (à gauche): radar SPY-1 du système Aegis ashore (à terre) qui opère en bande S. Figure 1.2 (à droite) : radar AN-TPY2 du système Thaad en bande X.","height":176,"width":540,"class":"media-element file-default"}}]]
Figure 1.1 (à gauche): radar SPY-1 du système Aegis ashore (à terre) qui opère en bande S. Figure 1.2 (à droite) : radar AN-TPY2 du système Thaad en bande X.
Figure 2 : le système Patriot est un système de défense aérienne et antimissile terrestre moyenne portée basse altitude, conçu principalement pour la lutte contre les missiles balistiques courte portée. Existant depuis les années 80, il est aujourd’hui dans une version PAC3, équipée d’un radar multifonction sectoriel en bande C (proposé dans le futur avec l’ajout d’antennes latérales) et doit être doté d’un missile amélioré dit MSE. Le système PATRIOT est un système 100% américain réalisé par Raytheon et Lockheed Martin.
[[{"fid":"2309","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Figure 2.1 (à gauche) : radar de tir du système Patriot. Figure 2.2 (à droite) : shelter de command control du système.","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Figure 2.1 (à gauche) : radar de tir du système Patriot. Figure 2.2 (à droite) : shelter de command control du système."},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Figure 2.1 (à gauche) : radar de tir du système Patriot. Figure 2.2 (à droite) : shelter de command control du système.","title":"Figure 2.1 (à gauche) : radar de tir du système Patriot. Figure 2.2 (à droite) : shelter de command control du système.","height":176,"width":540,"class":"media-element file-default"}}]]
Figure 2.1 (à gauche) : radar de tir du système Patriot.
Figure 2.2 (à droite) : shelter de command control du système.
Figure 3 : le système SAMP/T terrestre et les versions navales.
Le système d’armes franco-italien SAMP/T, par conception totalement dual, traite à la fois les menaces aériennes conventionnelles et les menaces balistiques de courte portée.
Les principaux atouts du SAMP/T sont notamment la défense de zone sur 360°, sa mobilité et son aéro-transportabilité sur les théâtres d’opérations extérieures. De conception et réalisation 100% européenne, il est développé et produit par THALES (responsable de la conduite de tir) et par MBDA (responsable du missile Aster et des lanceurs) à travers le consortium EUROSAM, en coopération entre la France et l’Italie. Le système SAMP/T est en service dans ces deux pays qui l’apportent comme contributions nationales au programme OTAN de défense antimissile balistique.
Une batterie SAMP/T comprend une Conduite de tir (radar multifonction Arabel (3.1) et Module d’Engagement (3.2)) et 3 à 4 Modules lanceur (3.3) chacun chargé de 8 missiles Aster 30 B1 (3.4). Le SAMP/T est en service opérationnel dans l’Armée de l’air française et dans l’armée de terre italienne. Il a effectué un tir en 2013 avec impact direct contre une cible de type SCUD coordonné avec l’OTAN via la liaison 16 pour lequel il a reçu le Technology Pioneer Award de 2015 (voir la Figure 3.5 et l’article dédié dans la lettre 3AF N°17). Le SAMP/T équipé du missile Aster 30 B1 répond aux besoins des missions anti aériennes actuelles et futures et continue d’évoluer. Fin 2015, un contrat a été notifié à Eurosam, MBDA et Thales pour le développement de la version SAMP/T B1NT dotée du missile Aster 30 B1NT (équipé d’un autodirecteur en bande Ka pour plus de précision) et une nouvelle conduite de tir pour améliorer les performances et l’adaptation du système aux nouvelles contraintes opérationnelles, dont la menace balistique de plus de 1000 km de portée. Le SAMP/T est doté d’une capacité de lutte 360° contre les missiles plongeants ou rasants supersoniques résultant de la conception d’une famille Sol Air Moyenne Portée à la fois terrestre et navale (voir Figure 4.1), bénéficiant d’une capacité de conduite de tir très performante contre des cibles très rapides y compris balistiques.
[[{"fid":"2310","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Figure 3.1 : radar Multifonction Arabel (Conduite de tir) Figure 3.2 : Module d’Engagement (Conduite de tir)","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Figure 3.1 : radar Multifonction Arabel (Conduite de tir) Figure 3.2 : Module d’Engagement (Conduite de tir)"},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Figure 3.1 : radar Multifonction Arabel (Conduite de tir) Figure 3.2 : Module d’Engagement (Conduite de tir)","title":"Figure 3.1 : radar Multifonction Arabel (Conduite de tir) Figure 3.2 : Module d’Engagement (Conduite de tir)","height":176,"width":540,"class":"media-element file-default"}}]]
Figure 3.1 (à gauche) : radar Multifonction Arabel (Conduite de tir)
Figure 3.2 (à droite) : Module d’Engagement (Conduite de tir)
[[{"fid":"2311","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Figure 3.3 (à gauche) : Module lanceur. Figure 3.4 (à droite) : Tir du missile Aster depuis le module lanceur.","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Figure 3.3 (à gauche) : Module lanceur. Figure 3.4 (à droite) : Tir du missile Aster depuis le module lanceur."},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Figure 3.3 (à gauche) : Module lanceur. Figure 3.4 (à droite) : Tir du missile Aster depuis le module lanceur.","title":"Figure 3.3 (à gauche) : Module lanceur. Figure 3.4 (à droite) : Tir du missile Aster depuis le module lanceur.","height":157,"width":540,"class":"media-element file-default"}}]]
Figure 3.3 (à gauche) : Module lanceur.
Figure 3.4 (à droite) : Tir du missile Aster depuis le module lanceur.
[[{"fid":"2312","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Figure 3.5 : Technology Pioneer Award décerné au SAMP/T et aux équipes qui ont contribué au tir ATBM coordonné entre le centre d’essais DGA de Biscarrosse et l’OTAN.","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Figure 3.5 : Technology Pioneer Award décerné au SAMP/T et aux équipes qui ont contribué au tir ATBM coordonné entre le centre d’essais DGA de Biscarrosse et l’OTAN."},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Figure 3.5 : Technology Pioneer Award décerné au SAMP/T et aux équipes qui ont contribué au tir ATBM coordonné entre le centre d’essais DGA de Biscarrosse et l’OTAN.","title":"Figure 3.5 : Technology Pioneer Award décerné au SAMP/T et aux équipes qui ont contribué au tir ATBM coordonné entre le centre d’essais DGA de Biscarrosse et l’OTAN.","height":144,"width":108,"class":"media-element file-default"}}]]
Figure 3.5 : Technology Pioneer Award décerné au SAMP/T et aux équipes qui ont contribué au tir ATBM coordonné entre le centre d’essais DGA de Biscarrosse et l’OTAN.
Par exemple, le SAMP/T a été conçu au départ, avec sa conduite de tir radar Arabel et le missile Aster 30, pour une protection 360° contre les missiles de croisière et les missiles rasants sea-skimmers, y compris pour son équivalent en version navale (système SAAM et PAAMS, voir Figure 4).
Figure 4 : autres systèmes européens et senseurs navals ou terrestres. Les versions navales des systèmes d’armes moyenne portée à base de missiles Aster sont adaptées à différentes missions et plateformes navales pour la France, l’Italie et la Grande-Bretagne et des marines non Européennes ( KSA, Maroc, Singapour). Les systèmes sont tous dotés des missiles Aster 15 et/ou Aster 30 avec le système de conduite de tir SAAM (Porte-avions Charles de Gaulle (FR), Frégate Sawari2 (KSA)) avec le radar Mutlifonction (MFR) Arabel en bande X (Figure 4.1), PAAMS pour les Frégates Horizon (FR,IT) avec les radars de surveillance LRR S1850 (de la famille SMART-L en bande L) (Figure 4.2), le radar MFR EMPAR en bande C (Figure 4.3), et T45 avec le radar S1850 de veille et le radar MFR SAMPSON en bande S (Figure 4.4). Les frégates FREMM, dotées aussi du missile Aster, sont équipées du radar MFR Herakles (Figure 4.5) ou Empar déjà cité pour l’Italie. Nous voyons que l’Europe contribue de multiples façons par ses technologies à une capacité de radar et conduite de tir multifonction et multifréquences, qui inclut aussi le radar démonstrateur MFCR en bande X du MEADS, destiné au futur système TLVS allemand (Figure 4.6).
[[{"fid":"2313","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Figure 4.1 (à gauche) : Système SAAM avec le radar MFR Arabel (bande X) monté sur le porte avion CDG et les frégates Sawari). Figure 4.2 (à droite) : radar LRR / S1850 (famille SMART-L en bande L) radar de surveillance aérienne sur les frégates Horizon (","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Figure 4.1 (à gauche) : Système SAAM avec le radar MFR Arabel (bande X) monté sur le porte avion CDG et les frégates Sawari). Figure 4.2 (à droite) : radar LRR / S1850 (famille SMART-L en bande L) radar de surveillance aérienne sur les frégates Horizon ("},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Figure 4.1 (à gauche) : Système SAAM avec le radar MFR Arabel (bande X) monté sur le porte avion CDG et les frégates Sawari). Figure 4.2 (à droite) : radar LRR / S1850 (famille SMART-L en bande L) radar de surveillance aérienne sur les frégates Horizon (","title":"Figure 4.1 (à gauche) : Système SAAM avec le radar MFR Arabel (bande X) monté sur le porte avion CDG et les frégates Sawari). Figure 4.2 (à droite) : radar LRR / S1850 (famille SMART-L en bande L) radar de surveillance aérienne sur les frégates Horizon (","height":157,"width":540,"class":"media-element file-default"}}]]
Figure 4.1 (à gauche) : Système SAAM avec le radar MFR Arabel (bande X) monté sur le porte avion CDG et les frégates Sawari).
Figure 4.2 (à droite) : radar LRR / S1850 (famille SMART-L en bande L) radar de surveillance aérienne sur les frégates Horizon (Franco-italiennes), T45 (UK), mais aussi allemandes, danoises, néerlandaises…
[[{"fid":"2314","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Figure 4.3 (à gauche) : radar MFR EMPAR des frégates Horizon françaises et italiennes (système PAAMS) en bande C. Figure 4.4 (à droite) : radar MFR SAMPSON des frégates T45 en bande S.","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Figure 4.3 (à gauche) : radar MFR EMPAR des frégates Horizon françaises et italiennes (système PAAMS) en bande C. Figure 4.4 (à droite) : radar MFR SAMPSON des frégates T45 en bande S."},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Figure 4.3 (à gauche) : radar MFR EMPAR des frégates Horizon françaises et italiennes (système PAAMS) en bande C. Figure 4.4 (à droite) : radar MFR SAMPSON des frégates T45 en bande S.","title":"Figure 4.3 (à gauche) : radar MFR EMPAR des frégates Horizon françaises et italiennes (système PAAMS) en bande C. Figure 4.4 (à droite) : radar MFR SAMPSON des frégates T45 en bande S.","height":157,"width":540,"class":"media-element file-default"}}]]
Figure 4.3 (à gauche) : radar MFR EMPAR des frégates Horizon françaises et italiennes (système PAAMS) en bande C.
Figure 4.4 (à droite) : radar MFR SAMPSON des frégates T45 en bande S.
[[{"fid":"2315","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Figure 4.5 : radar MFR Herakles (4.5a, ci-contre) en bande S des frégates FREMM françaises participant aux essais IAMD maritime At Sea Demo 2015 (4.5b ci-dessous) pour réaliser une mission de détection et poursuite autonome antimissile balistique compatib","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Figure 4.5 : radar MFR Herakles (4.5a, ci-contre) en bande S des frégates FREMM françaises participant aux essais IAMD maritime At Sea Demo 2015 (4.5b ci-dessous) pour réaliser une mission de détection et poursuite autonome antimissile balistique compatib"},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Figure 4.5 : radar MFR Herakles (4.5a, ci-contre) en bande S des frégates FREMM françaises participant aux essais IAMD maritime At Sea Demo 2015 (4.5b ci-dessous) pour réaliser une mission de détection et poursuite autonome antimissile balistique compatib","title":"Figure 4.5 : radar MFR Herakles (4.5a, ci-contre) en bande S des frégates FREMM françaises participant aux essais IAMD maritime At Sea Demo 2015 (4.5b ci-dessous) pour réaliser une mission de détection et poursuite autonome antimissile balistique compatib","height":157,"width":540,"class":"media-element file-default"}}]]
Figure 4.5 : radar MFR Herakles (4.5a, ci-contre) en bande S des frégates FREMM françaises participant aux essais IAMD maritime At Sea Demo 2015 (4.5b ci-dessous) pour réaliser une mission de détection et poursuite autonome antimissile balistique compatible de sa mission de défense aérienne.
[[{"fid":"2316","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":156,"width":229,"class":"media-element file-default"}}]]
[[{"fid":"2317","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Figure 4.6 : radar MFCR en bande X du démonstrateur du système MEADS, destiné au futur système allemand TLVS.","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Figure 4.6 : radar MFCR en bande X du démonstrateur du système MEADS, destiné au futur système allemand TLVS."},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Figure 4.6 : radar MFCR en bande X du démonstrateur du système MEADS, destiné au futur système allemand TLVS.","title":"Figure 4.6 : radar MFCR en bande X du démonstrateur du système MEADS, destiné au futur système allemand TLVS.","height":157,"width":540,"class":"media-element file-default"}}]]
Figure 4.6 : radar MFCR en bande X du démonstrateur du système MEADS, destiné au futur système allemand TLVS.
Le projet EPAA a aussi permis initialement de délier la situation avec les Russes sur la question de la défense antimissile territoriale, alors qu’une coopération existait déjà entre l’OTAN et la Russie sur l’interopérabilité des systèmes antimissiles de théâtre. En proposant de nouvelles discussions sur les accords « New Start Treaty», et en ouvrant le dialogue sur la défense antimissile en séparant nettement le champ de la défense intercontinentale d’avec celui de la défense moyenne portée, dérivée de la défense de théâtre, l’administration Obama entreprenait une démarche de dialogue. Elle donna le ton du sommet de l’OTAN de 2010 à Lisbonne, suivi du sommet OTAN-Russie. C’est lors de ce sommet que l’OTAN décida d’explorer sérieusement la faisabilité d’une défense antimissile du territoire et de la coopération avec la Russie, qui elle-même admettait que la prolifération des missiles balistiques ne se limitait désormais plus aux seuls missiles balistiques très courte portée (quoique largement les plus répandus).
L’US EPAA fut donc une approche novatrice car elle a changé la priorité sur la menace, prenant tout d‘abord en compte les MRBMs (phases 1 et 2), puis les IRBMs (phase 3), considérant les ICBMs comme une menace secondaire (phase 4 finalement abandonnée) vis à vis de l’Europe et de l’OTAN (selon la BMD Review américaine de début 2009). Elle préconisait en outre, une défense mobile, reconfigurable, comme la défense de théâtre, principalement navale. Les décisions de principe de Lisbonne se sont concrétisées à Chicago en 2012 avec la déclaration du caractère opérationnel de la capacité de défense antibalistique intermédiaire de l’OTAN « BMD Interim Capability », principalement à base de systèmes Aegis américains, couvrant partiellement l’Europe. Cette déclaration était assortie de la décision de procéder ensuite à l’expansion BMD de l’ALTBMD pour couvrir l’ensemble du territoire européen de l’OTAN. Cette défense était placée sous contrôle de l’OTAN et de son centre de commandement BMDOC à Ramstein. L’objectif final était donc de protéger tous les territoires, les populations et les troupes des nations membres contre les missiles balistiques sur le territoire européen de l’Alliance atlantique, tout en réaffirmant que la BMD intervenait comme un complément à la dissuasion nucléaire de l’OTAN et ne pouvait s’y substituer.
Ces décisions étaient assorties aussi de conditions sur les principes de consultation et de règles d’engagements communes, sur la maitrise des coûts, la contribution de l’industrie européenne, sans oublier la recherche d’une coopération avec la Russie, laquelle possède un système de dissuasion en cours de modernisation, et n’en développe pas moins ses propres systèmes de défense IAMD basse et haute altitude tels que le S300-PMU2, le S400 et le S500. La Russie conçoit la défense face aux menaces spatiales, balistiques et aériennes en incluant des missiles MRBM/IRBM voire ICBM – comme une capacité qui, à la différence des projets de l’OTAN ou américains, est destinée prioritairement à se protéger contre « une menace de frappe en premier» contre les centres de commandement stratégiques russes, qui pourrait affaiblir sa dissuasion. La Russie complète aussi ses défenses de théâtre et ses défenses aériennes face aux missiles de croisière et à une aviation de combat moderne. Le concept politique de la Missile Defense ou de l’IAMD russe est donc radicalement différent de celui des USA ou de l’OTAN, même si les développements peuvent être similaires. La Russie a d’ailleurs totalement intégré le commandement de défense spatiale, aérienne et antimissile.
Cependant, les débats continuent sur la menace. La crise en Syrie a d’ailleurs déjà démontré la réalité d’un usage quotidien d’une menace aérienne conventionnelle et balistique; sur le territoire syrien, plus de 500 missiles balistiques courte-portée ainsi que des bombes conventionnelles ont été tirés contre des combattants et la population. Il a donc fallu déployer un système à capacité de défense « duale anti aérien et antibalistique » près de la frontière, du côté turc. Des territoires proches des nations membres de l’OTAN peuvent donc être exposés à des tirs de missiles de croisière ou balistiques : le sujet ne devrait plus être un tabou. On doit se souvenir aussi du scénario du 11 Septembre, impensable auparavant. Les menaces « terroristes » aériennes sont prises en compte en Europe aussi et des exercices nationaux ont été menés après le 11 septembre dans un cadre Euro-atlantique avec une participation de l’OTAN, des pays européens, et même de la Russie pour certains exercices.
Un consensus reste à atteindre, même au sein de l’OTAN, sur l’hypothèse d’une menace duale proliférante qui viserait le territoire de l’alliance. Plus récemment, l’exemple du Yémen a montré aussi que des forces non gouvernementales peuvent s’emparer de missiles balistiques courte portée et en faire usage, passant de l’âge de la roquette rustique à celui du missile balistique courte portée. Mais trouver un consensus élargi nécessite aussi de garantir le respect de l’intégrité territoriale et des espaces aériens pour tous les pays…avant que de parler de coordination des engagements d’intercepteurs antimissiles balistiques haute altitude.
De la défense antimissile à l’IAMD
Or s’il n’y a pas encore de consensus sur toute la menace, il n’y en a pas encore sur le choix entre BMD et IAMD. La « Theatre Missile Defence » fut pourtant dès l’origine une architecture IAMD contre les menaces duales. Mais elle reste une architecture destinée au théâtre extérieur, alors que la défense du territoire est devenue un enjeu prépondérant sur l’impulsion de l’EPAA américaine, en raison de l’évolution de la menace balistique mais aussi conventionnelle et des enjeux de souveraineté en Europe ou d’influence politique régionale, pour les USA, pour la Russie, sans oublier les pays européens, les premiers concernés. En effet, le Commandement de la BMD longue portée soulève de par sa large empreinte géographique au-delà des frontières nationales, des questions de souveraineté et de décisions collectives qui nécessitent un processus de consultation préalable pour s’accorder sur les règles d’engagement et leurs conséquences (retombées de débris).
De même, les tensions avec la Russie sur fond de crise ukrainienne ont évidemment ravivé le besoin de garantir la sécurité des espaces aériens nationaux, et donc l’importance de la défense aérienne. Pour autant, la BMD territoriale, conçue comme une expansion de l’ALTBMD, aurait une capacité duale intrinsèque liée notamment au système de commandement et de contrôle ACCS (Air Command and Control System) de l’OTAN. Les systèmes d’armes et les senseurs européens et américains, déployés dans l’espace, au sol ou en mer, sont d’ailleurs déjà reliés au centre de commandement Air de l’OTAN à Ramstein en Allemagne (BMDOC) avec l’ACCS qui est déjà en cours d’évolution (ACCS TMD), pour élargir ses missions à la défense antimissile balistique. L’ACCS assure d’ailleurs toutes les opérations aériennes de l’OTAN en temps réel, en lien avec le système intégré de défense aérienne de l’OTAN (NATINAMDS) et les systèmes C2 nationaux eux-mêmes basés sur des réplications du système ACCS dans les centres de contrôle de l’OTAN. Ce système de commandement et de contrôle OTAN est interfacé avec le centre de commandement « Ballistic Missile Defense » des Etats-Unis, le C2BMC, qui coiffe de son côté, tous les systèmes antimissiles américains de l’EPAA – systèmes Aegis naval puis terrestre, et radar d’alerte AN-TPY2 en Turquie. Tous les systèmes de l’OTAN partagent la tenue de situation balistique « situational awareness » à partir de Ramstein, mais pas la capacité aérienne alors que l’ACCS le permet déjà pour la défense et les opérations aériennes de l’OTAN. Le concept d’emploi BMD peut donc évoluer vers une architecture IAMD où, à l’instar de la défense de théâtre, la défense territoriale BMD de l’OTAN ne serait plus focalisée sur la seule menace balistique mais rejoindrait la défense aérienne de l’OTAN et le NATINAMDS. Pour certaines nations en Europe, l’IAMD apparaît bien comme une « priorité », autant que la « Theatre Missile Defence », d’autant plus que certaines sont directement exposées à des menaces aériennes conventionnelles. Peut-être atteindra-t-on un consensus, tôt ou tard. Le NATINAMDS existe, et le concept américain de défense aérienne et antimissile « IAMD » existe aussi pour d’autres systèmes, notamment naval avec le concept d’engagement coopératif (CEC) de l’US Navy, ou pour des applications de défense dans d’autres pays hors Europe.
La décision de réaliser une architecture de défense antimissile du territoire européen avec un commandement intégré sous la responsabilité de l’OTAN a été prise par les nations en 2010 (Sommet de Lisbonne) , avec un financement collectif du système de commandement qui doit inclure un processus de planification et de consultation avec des règles d’engagement communes et une évaluation des conséquences d’interception partagée. C’est un enjeu politique de premier plan. Différents pays ont d’ailleurs mené des travaux exploratoires pour comparer leur approche du processus de planification et de décision, dont la France qui a développé un démonstrateur de C2 antimissile pour évaluer les processus de planification et d’exécution compatibles du C2 de l’OTAN (voir Figure 5) ou d’autres pays, qui ont développé des outils d’évaluation des conséquences d’interception.
Figure 5 : Le Ministère de la Défense français (DGA,DGRIS, EMA) a fait développer un démonstrateur fonctionnel de C2 BMD nommé « IDEFIX » de façon à étudier les concepts d’opération de Défense antimissile balistique du territoire et des populations, à évaluer des concepts opérationnels de planification (5.1) et de conduite des opérations, en y intégrant les directives politiques aux différents niveaux stratégiques, opératifs et techniques d’interopérabilité en mode autonome ou coordonné avec le C2 BMD de l’OTAN (5.2 et 5.3).
[[{"fid":"2318","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Figure 5.1","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Figure 5.1"},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Figure 5.1","title":"Figure 5.1","height":157,"width":540,"class":"media-element file-default"}}]]
Figure 5.1
[[{"fid":"2319","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Figure 5.2","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Figure 5.2"},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Figure 5.2","title":"Figure 5.2","height":157,"width":540,"class":"media-element file-default"}}]]
Figure 5.2
[[{"fid":"2320","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Figure 5.3","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Figure 5.3"},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Figure 5.3","title":"Figure 5.3","height":157,"width":540,"class":"media-element file-default"}}]]
Figure 5.3
L’ACCS de l’OTAN, dont les fonctions sont étendues à la capacité antimissile de théâtre (ACCS TMD), a d’ailleurs été développé conjointement par l’industrie américaine et européenne via ThalesRaytheonSystems (joint-venture entre les deux entreprises Raytheon et Thales) avec d’autres acteurs industriels européens et américains. Après le sommet de Chicago, l’OTAN avait d’ailleurs demandé plus de coopération entre les nations au travers d’une « smart defense ». Concernant la Missile Defense, certains pays évoquaient un « pooling and sharing des missiles SM3 américains », tandis que d’autres voyaient dans la capacité antimissile navale, et notamment d’alerte, un sujet de coopération.
Peut-on envisager une contribution équilibrée à l’IAMD : quelles initiatives venant d’Europe ?
Pour en arriver à un consensus global sur le sujet, il faudrait aussi une contribution plus équilibrée entre les pays européens et les Etats-Unis, via des contributions au financement collectif de l’OTAN. Il faudrait aussi que les efforts de Défense des nations atteignent 2% du PIB national (ce qui devient une évidence compte tenu des attaques terroristes récentes menées contre l’Europe au sens large mais aussi contre les USA ou même la Russie), demande qui a été exprimée au sommet de l’OTAN au Pays de Galles en septembre 2014. Ce n’est pas facile à une époque où les budgets de défense sont déjà mis sous forte pression, mais la sécurité ou la défense sont-elles le fait et l’obligation de quelques nations européennes ou américaine, tant pour les actions extérieures que pour les contributions à l’OTAN ? Cette obligation collective est-elle compatible des efforts de développement des équipements et de défense de quelques nations ? Ne pourrait-on alléger leurs contraintes budgétaires si elles sont au profit d’une contribution à l’effort de défense collectif? L’appréciation des priorités et des besoins semble assez différente entre l’OTAN et l’UE.
Les Etats-Unis ont déjà investi environ entre 2 et 3 milliards de dollars US dans l’EPAA en Europe, ce qui est remarquable, mais quelques nations européennes ont aussi déjà investi des milliards d’euros dans des systèmes de défense aérienne aujourd’hui en cours de développement, voire opérationnels. Par exemple les Pays-Bas développent un système de capacité d’alerte basé sur le radar naval Smart–L EWC (voir Figure 6) d’abord naval, voire aussi terrestre.
[[{"fid":"2321","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Figure 6 : Radar SMART-L EWC d’alerte et poursuite longue portée naval (6a, à gauche) et en version terrestre (6b, à droite)","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Figure 6 : Radar SMART-L EWC d’alerte et poursuite longue portée naval (6a, à gauche) et en version terrestre (6b, à droite)"},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Figure 6 : Radar SMART-L EWC d’alerte et poursuite longue portée naval (6a, à gauche) et en version terrestre (6b, à droite)","title":"Figure 6 : Radar SMART-L EWC d’alerte et poursuite longue portée naval (6a, à gauche) et en version terrestre (6b, à droite)","height":157,"width":540,"class":"media-element file-default"}}]]
Figure 6 : Radar SMART-L EWC d’alerte et poursuite longue portée naval (6a, à gauche) et en version terrestre (6b, à droite)
Figure 7 : Le radar d’alerte Très Longue Portée UHF est développé par la France avec Thales et l’ONERA qui réalisent une version réduite (1/8ème de l’antenne complète) (7a) qui est en cours de tests et d’intégration. Cette antenne modulaire est basée sur des modules actifs Emission/réception en sous-panneaux (7b). L’antenne en version complète intègre les huit colonnes (7c).
[[{"fid":"2322","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Figures 7a, 7b, 7c","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Figures 7a, 7b, 7c"},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Figures 7a, 7b, 7c","title":"Figures 7a, 7b, 7c","height":157,"width":540,"class":"media-element file-default"}}]]
Figures 7a, 7b, 7c
La France, quant à elle, développe un radar très longue portée basé au sol (voir Figure 7), et a déjà réalisé un système satellitaire expérimental, Spirale, pour mener des tests relatifs à l’alerte spatiale antimissile (voir Figure 8). La France et l’Italie ont aussi investi des milliards d’euros dans un système de missile sol-air avec 100% de technologie européenne, basé sur le radar Multifonction Arabel et le missile Aster 30 (voir Figures 3 et 4).
Figure 8 : démonstrateur spatial Spirale (Figure 8.1)
L’expérimentation Spirale incluait deux microsatellites équipés d’imageurs spectraux IR (réalisés par ThalesAleniaSpace sous responsabilité système Astrium ST sous contrat du Ministère de la Défense français (DGA). L’expérimentation Spirale a permis de collecter de nombreuses images à haute résolution du fond de terre dans l’infrarouge (Figure 8.2) mais aussi d’observer des lancements d’opportunité (missiles et lanceurs).
[[{"fid":"2323","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Figure 8.1","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Figure 8.1"},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Figure 8.1","title":"Figure 8.1","height":192,"width":221,"class":"media-element file-default"}}]]
Figure 8.1
[[{"fid":"2324","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Figure 8.2","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Figure 8.2"},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Figure 8.2","title":"Figure 8.2","height":96,"width":221,"class":"media-element file-default"}}]]
Figure 8.2
Il a été testé avec succès contre les cibles « air-breathing » mais aussi contre des missiles balistiques. Des améliorations supplémentaires du système « de conduite de tir » et des missiles Aster 30 B1 NT sont prévues, ainsi que le développement des nouvelles antennes actives électroniques multi-fonctions pour des applications navales (SF500) ou terrestres (GF-1000) (voir Figure 9). Evidemment, les investissements continuent aussi au Danemark (SMART-L système naval), en Allemagne avec le système TLVS dérivé du MEADS (voir Figure 4.6), en Italie, en Pologne, en Turquie, au Royaume-Uni et d’autres, qui ont des plans prévisionnels pour modifier ou développer leurs capacités antimissiles et antiaériennes. Cependant, au plan économique, un retour sur investissement est essentiel en Europe comme ailleurs, pour accompagner de nouveaux développements. Les responsables européens de la défense sont donc confrontés à des choix difficiles, ayant des contraintes budgétaires fortes, tout en maintenant une dépense proche de 2% du PIB. Pour le spatial, ils donnent la priorité à l’investissement dans les satellites militaires de communication et d’observation, mais aussi dans les satellites civils ou les lanceurs spatiaux comme Ariane 6. Parallèlement, ils continuent de très importants investissements dans l’amélioration des systèmes IAMD « dual lower layer », comme par exemple les plateformes de missiles sol-air. Ils privilégient aussi l’investissement dans les capacités navales antimissiles.
L’impression persiste, qu’elle soit fondée ou non, que les Etats-Unis fournissent principalement des solutions américaines et que l’accès au marché est un problème réel pour l’industrie européenne, pour maintenir et développer ses compétences. Mais une industrie européenne faible est un risque pour tous. Sans valeur ajoutée européenne ni retour sur investissement, l’investissement dans la Défense va diminuer régulièrement. Cela signifie que, sur le long terme, il y aura besoin de plus d’investissements des Etats-Unis pour maintenir la sécurité en Europe, avec plus de risques pour tout le monde.
Figure 9 : Future famille de radars SF/GF AESA bande S destinée à la FREMM/ FREDA, mais aussi au futur radar MFR d’alerte/poursuite longue portée GF1000. Faisant suite au démonstrateur GS1000/M3R lancé en 2004 et aux radars de défense aérienne de la classe GM400, ils bénéficient d’une technologie AESA de nouvelle génération permettant de réaliser un radar entièrement numérique.
Sur les FREMMs, de nouveaux radars AESA 4 panneaux fixes SF500 (Figure 9.1) en bande S viendront remplacer le radar Multifonction Herakles à terme. La version terrestre de radars Multifonctions moyenne/longue portée à antenne AESA GF1000 (Figure 9.2) bénéficie aussi de la même technologie d’antenne, pour être couplée à terme au SAMP/T B1NT. Thales prépare la mise sur le marché d’une nouvelle génération de radars de technologie AESA, avec une chaîne de réception entièrement numérique (FD-AESA), disponibles en versions navales et terrestres, à panneaux fixes ou tournants.
Ces radars sont modulaires et permettent de couvrir l’ensemble des gammes de puissance uniquement par le dimensionnement de l’antenne et ajustement du nombre de modules d’émission / réception qu’elle intègre. Les fonctionnalités de cette gamme de radars couvrent les menaces ABT (Air Breathing Targets) et TBM (Tactical Ballistic Missiles) et gèrent la composante effecteur par l’intégration au radar d’une fonctionnalité de liaison montante missile. Un haut niveau de performances en veille et en poursuite est atteint grâce à la capacité multifaisceaux simultanés (>50) et grâce à des motifs de surveillance et de poursuite reconfigurables selon les missions et les cibles (voir Figure 9.3).
[[{"fid":"2325","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Figure 9.1 (à gauche) : radar SF500 4 panneaux fixes Figure 9.2 (à droite) : radar GF1000 MFR terrestre longue portée","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Figure 9.1 (à gauche) : radar SF500 4 panneaux fixes Figure 9.2 (à droite) : radar GF1000 MFR terrestre longue portée"},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Figure 9.1 (à gauche) : radar SF500 4 panneaux fixes Figure 9.2 (à droite) : radar GF1000 MFR terrestre longue portée","title":"Figure 9.1 (à gauche) : radar SF500 4 panneaux fixes Figure 9.2 (à droite) : radar GF1000 MFR terrestre longue portée","height":96,"width":221,"class":"media-element file-default"}}]]
Figure 9.1 (à gauche) : radar SF500 4 panneaux fixes
Figure 9.2 (à droite) : radar GF1000 MFR terrestre longue portée
[[{"fid":"2326","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Figure 9.3 : gestion multifaisceaux par paquets ","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Figure 9.3 : gestion multifaisceaux par paquets "},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"alt":"Figure 9.3 : gestion multifaisceaux par paquets ","title":"Figure 9.3 : gestion multifaisceaux par paquets ","height":132,"width":221,"class":"media-element file-default"}}]]
Figure 9.3 : gestion multifaisceaux par paquets
Un exemple d’initiative transatlantique pour plus de coopération
La coopération entre les pays pourrait aussi être améliorée par des systèmes utilisant en plus de la chaine de commandement et de contrôle de l’OTAN, des assemblages (clusters) de senseurs et systèmes de conduite de tir IAMD en réseau (voir Figure 10). L’effet recherché serait d’obtenir une interopérabilité temps réel entre les systèmes d’armes et de permettre plus de synergie entre eux, renforçant ainsi leurs performances et leur résilience, tout en ouvrant simultanément des voies de coopération et d’interopérabilité supplémentaires, en complément des modes d’interopérabilité déjà développés autour des C2 de l’OTAN et des liaisons de données du type L16. Une initiative sur le thème « multisensor cooperation » avait d’ailleurs été prise fin 2013 par deux think tanks transatlantiques (3AF invité par l’Atlantic Council US). Elle fut ensuite poursuivie par la 3AF avec le concours d’industriels transatlantiques (17) qui ont rédigé un White Paper intitulé « study of IAMD sensors networking », sujet d’étude proposé au NIAG fin 2014, avec un intérêt particulier pour l’étude des Multisensor Fire Control Networks.
Figure 10 : concept de réseau de senseurs MFR de conduite de tir assemblés en clusters.
L’intégration des systèmes IAMD ou antimissiles passe par l’interopérabilité des Centres de Command Control (C2) et des senseurs afin de partager les informations de situation (Situational Awareness) et de coordonner les engagements. Ceci est obtenu par le biais des C2 OTAN interopérables avec les C2 et systèmes nationaux (senseurs, systèmes d’armes) et des liaisons tactiques de type L16 qui véhiculent les messages entre les systèmes, suivant des normes d’interopérabilité adoptées par tous. Au delà, l’évolution des technologies de senseurs décrites notamment par les radars MFR et les antennes actives, permet, conjuguée à l’évolution des moyens de communication, d’envisager des modes d’interaction supplémentaires entre les senseurs de conduite de tir au bas des chaines d’engagement. Ainsi, on pourra faire dialoguer plusieurs radars MFR de conduite de tir, pour échanger des ressources et former « un cluster de senseurs » opérant conjointement au travers de liaisons rapides. L’avantage opérationnel résultant en sera une meilleure résilience des systèmes aux effets de saturation et de contre-mesures grâce à un équilibrage en temps réel des ressources entre senseurs qui peuvent fonctionner en outre à différentes fréquences.
Du point de vue économique et industriel, ce serait également faciliter l’interopérabilité entre senseurs de technologies et fréquences différentes, donc une valeur ajoutée à la construction de systèmes de systèmes à partir de briques différentes, lorsque des pays auront décidé de coopérer en assemblant pour une mission et un temps donnés, deux ou plusieurs systèmes d’armes pour former un cluster, chacun d’entre eux gardant la maitrise de ses lanceurs de missiles et de sa mission, tout en mettant à disposition une capacité senseur au profit de son « partenaire ».
[[{"fid":"2327","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","link_text":null,"attributes":{"height":228,"width":477,"class":"media-element file-default"}}]]
Alors que les industries de défense européennes et américaines sont parfois critiquées pour s’affronter plutôt que de coopérer, la compétition n’empêche pas l’industrie de proposer des idées pour augmenter la synergie des systèmes et pour renforcer leur efficacité globale.
Parfois, la volonté politique manque pour favoriser la cohésion plutôt que la compétition réputée garantir le meilleur prix, ce qui serait justifié si les budgets étaient abondants. Ils ne le sont pas. L’industrie américaine souffre du « budget sequestration » mais dispose d’un budget de soutien aux opérations extérieures considérable, et de contrats FMS, tandis que l’industrie européenne dont le savoir-faire est aussi indéniable, est à la diète depuis des années !
Un consensus sur la défense aérienne et antimissile basé sur la dynamique d’expansion de la BMD OTAN est certainement accessible, mais seulement dans certaines conditions. La menace duale devrait être une priorité partagée, et permettre une capitalisation sur les capacités duales de l’OTAN, et des industries, et notamment de la défense de théâtre. La synergie entre les industries des Etats-Unis et d’Europe doit être renforcée, créant une valeur ajoutée pour les compétences américaines et européennes, et un accès égal au marché, y compris export. Finalement, la synergie des systèmes et des senseurs entre eux pourrait être améliorée, ce qui relève non seulement de la technique et du savoir-faire industriel pour proposer des solutions innovantes, mais aussi d’une volonté politique pour favoriser de telles synergies, ce qui prend du temps. ?







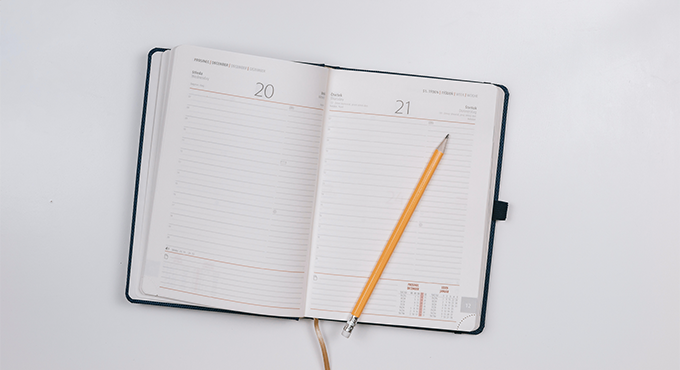

Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.