News

Appontage d'hélicoptères : des simulations pour l'aide au pilotage
Par Laurent Binet, chef de l'unité de recherche « Dynamique du vol et Systèmes Voilures
Tournantes », ONERA
Les manœuvres d’appontage et de décollage à partir de navires peuvent se révéler particulièrement complexes pour les hélicoptères. Outre les appareils embarqués sur porte-avions, d’autres le sont sur de plus petits bâtiments (frégates par ex.) rendant les manœuvres de décollage et d’atterrissage plus complexes encore. Mais d’autres opérations maritimes nécessitent l’utilisation d’hélicoptères avec pour chacune d’elles des problématiques propres. Par exemple, si les opérations de sauvetage en mer ne requièrent habituellement pas de se poser sur un navire, l’hélicoptère devra réaliser des stationnaires et des manœuvres à basses vitesses au-dessus des personnes à sauver, et ce dans des conditions météorologiques parfois difficiles. On peut également mentionner les opérations effectuées sur plateformes offshores où certes le point de poser ne bouge pas, mais reste exigu et souvent proche d’antennes ou de structures participant de plus à une aérologie perturbée.
L’appontage des hélicoptères : une manœuvre hors normes
Ainsi quel que soit le contexte, les opérations d’appontage imposent un grand nombre de défis. C’est d’autant plus vrai pour les opérations d’appontage sur les bâtiments de la Marine. Outre l’exiguïté du pont et le niveau de sécurité extrêmement élevé requis, les mouvements du navire en fonction de l’état de mer, le sillage aérien turbulent derrière le navire, les conditions météorologiques parfois difficiles, l’environnement visuel potentiellement dégradé (pluie, embruns, vol de nuit), les obstacles autour du pont et la sécurité des personnels de bord sont autant de problématiques à prendre en compte durant ces opérations. Ces problématiques nécessitent du pilote des manœuvres très précises, à forte charge de travail particulièrement de nuit, et un pilotage à haute intensité totalement différent de toutes autres missions.


Montage photo montrant un appontage de jour et de nuit - Hélicoptère Panther sur la frégate anti-aérienne Cassard en 2012 – Crédit Capitaine de corvette Gwenaël Teveu
superstructures (antennes, radars, etc…).
L’approche et la phase de poser étant opérées parfois à basses vitesses par rapport à l’air, le niveau de puissance nécessaire peut être important et la réserve de puissance limitée. Le pilote doit dans ce cas être vigilant quant aux performances de sa machine en stationnaire et aux basses vitesses et prendre en compte les possibles « sur-couple » pour contrôler le lacet et l’axe vertical.
• du mouvement et des repères visuels du navire sur les performances de l'hélicoptère ;
• du contrôle de l’hélicoptère et de la charge de travail du pilote dans diverses conditions:
o de mer,
o de vent,
o et d‘environnement visuel (jour/nuit/vision dégradée).
En France, la détermination de l’enveloppe opérationnelle est faite en deux temps.
2 – Établissement des SHOL (Ship Helicopter Operating Limits)1 : Le CEPA/10S (Centre
d‘Expérimentations Pratiques et de réception de l‘Aéronautique navale) établit pour chaque
couple navire/hélicoptère le SHOL à partir du domaine précédent via des expérimentations en vol.
infrastructure) ou à l’hélicoptère (ex : passage de la version du Tigre HAP à la version HAD), il est alors nécessaire de refaire le SHOL.
Si de nombreuses études portent sur l’appontage, le décollage est au moins aussi complexe
et malgré tout très peu étudié. Le décollage est une manœuvre difficile du fait :
• des mouvements navire + houle/vagues lorsque l’hélicoptère est toujours arrimé;
• des mouvements du navire au moment du « déjaugeage » ;
• du sur-couple possible (hélicoptère lourd / puissance requise importante au décollage)
Auxquelles s’ajoutent la plupart des problématiques de l’appontage…
Des simulations pour l'aide au pilotage
La simulation de ces procédures requiert le développement et la mise en œuvre de différents outils et modèles pour proposer des aides au pilotage ou estimer les limites opérationnelles d’un hélicoptère sur un navire. Simuler de manière réaliste ces manœuvres reste cependant difficile car devant mettre en œuvre un grand nombre de modélisations telles que :
• des modèles pour la dynamique du vol de l’hélicoptère (capable d’intégrer les perturbations aérodynamiques locales à différents points du modèle numérique de l’hélicoptère) et les systèmes de bords qui soient représentatifs des simulations pilotées ;
• un modèle de dynamique réaliste des mouvements navire ;
• un modèle de houle / état de mer – couplé au modèle du navire ;
• un environnement visuel réaliste (modèle 3D navire, mer, atmosphérique, etc.) pour une simulation pilotée ;
• un modèle du sillage aérodynamique du navire, idéalement instationnaire et couplé au mouvement navire ;
• idéalement encore, un couplage « fort » entre le sillage du rotor hélicoptère et le sillage navire (mais ce n’est pas encore fait !)
Parmi les différents axes de recherche, un exemple de problématique mettant en œuvre l’ensemble des modélisations citées précédemment est l’estimation ou la prédétermination de points critiques des SHOLs par la simulation. Si la détermination du SHOL devait dans tous les cas être réalisée/confirmée par des essais en vol, cela pourrait permettre de limiter le nombre d’essais (il faut une vingtaine d’heures pour déterminer un SHOL) et de valider expérimentalement les points critiques pré-estimés.
Par ailleurs, la mesure du sillage navire, en soufflerie ou par calcul, reste très importante et a pour objectifs de :
• déterminer les zones de turbulences pour les hélicoptères ;

Porte hélicoptère dans la soufflerie ONERA-L2 de Lille. Crédit ONERA.
Réaliser des essais en soufflerie sur des maquettes de navire restant une opération complexe et coûteuse, le développement de méthodes numériques adaptées à ces problématiques devient une priorité pour aider à concevoir les navires et mieux comprendre les phénomènes aérodynamiques. Il est à noter que la prise en compte des mouvements de plateforme rajoute de la complexité à la mise en œuvre des calculs et qu’il est recherché des méthodes de calculs plus rapides que les méthodes CFD « traditionnelles ».
Les axes de recherche pour des simulations pilotées/d’entraînement plus réalistes portent sur :
• l’intégration de sillages dynamiques dans la mécanique de vol et la boucle de vol du simulateur ;
• l’amélioration de l’environnement de simulation (visualisation, mouvement du navire, état de mer).
L’automatisation de ces phases de vol, l’évaluation de lois de pilotage spécifiques ou le développement de systèmes d’aides aux équipages sont encore d’autres sujets d’études.
• le recours aux systèmes de contrôle automatique de vol (modes supérieurs) ;
• l’atterrissage automatique sur le pont d'un navire de drones /ou d’appareils « classiques » ;
• l’utilisation de modes automatiques « basés vision » ;
• l’estimation en temps réel de fenêtres d’appontage ;
• la prédiction des conditions de « Roll over » (basculement en roulis de l’appareil suite au toucher) ;
• le contrôle automatique de la charge suspendue d'un hélicoptère pour les opérations d’élingage

Développement de lois de pilotage par objectifs pour l’aide à l’appontage avec utilisation de la technologie mini-manches actifs – Banc de simulation PycsHel. Crédit ONERA
L’arrivée du drone à bord des navires
Toutes les problématiques abordées précédemment ainsi que les multiples axes de recherche resteront d’actualité encore longtemps pour les hélicoptères pilotés, mais plus encore pour la mise en service des drones à voilures tournantes à bord des navires. Leur arrivée préfigure une révolution avec entre autres :
• l’extension très importante du champ de « vision » du navire ;
• la sécurité des équipages.
On peut citer le démonstrateur de Décollage et d'Appontage Automatiques de Drones (D2AD). Ce projet d'études amont avait été notifié à la DCNS2 et Thales qui ont conçu et réalisé ce démonstrateur. Une trentaine de phases de décollage et d'appontage du drone H-6U « Little Bird », conçu par Boeing à partir de l’hélicoptère MD 530, ont été effectués à partir de la frégate Guépratte fin 2012. Ce projet d'études amont fut un jalon majeur dans le processus de levée de risques du futur programme de Système de Drones Aériens de la Marine (SDAM).
Depuis 2010, le Centre d’Expérimentations Pratiques de l’Aéronautique navale (CEPA) expérimente le drone S100 Camcopter de Schiebel, véritable mini-hélicoptère qui permet de s’approprier les spécificités d’un système de drone aérien VTOL (Vertical Take-Off and Landing) et sa charge utile. En novembre 2019, à la suite de la qualification par la Direction Générale de l’Armement (DGA), le S100 a intégré la flotte des PHA (Porte-Hélicoptère Amphibie).
Ce drone préfigure le SDAM, Système de Drone Aéro-Maritime, dont le vecteur en cours d’expérimentation est le VSR 700. Il s’agit d’une évolution de l’hélicoptère léger Cabri G2 de Guimbal Aviation réalisé en coopération avec Airbus Helicopters. Le démonstrateur a effectué des vols autonomes en mai 2017 et le premier vol non piloté et entièrement autonome a été réalisé en 2018. Des appontages ont ensuite été réalisés au large de Brest en mars 2022 et le premier vol libre du VSR 700 effectué en juillet 2022. Une campagne d’essais en mer sur la frégate FREMM Provence a enfin été réalisée en octobre 2023.

VSR700 : Campagne d'essais d’appontage sur le navire VN Partisan – Mai 2023
Crédit Airbus HELICOPTERS 2023 par Éric RAZ.
• disposer d’un système de pilotage autonome fiable ;
• disposer d’un système de contrôle à longue distance robuste ;
• concevoir un système d’appontage et de décollage automatique fiable ;
• établir une liaison de données (sécurisées…) entre le navire et le drone ;
• améliorer le rapport performance/masse des capteurs ;
• assurer la compatibilité électromagnétique entre le drone et les différents capteurs, radars et systèmes de communication du navire ;
• intégrer le vecteur sur un navire où opère déjà un hélicoptère embarqué …
En conclusion, si les opérations d’appontages et de décollages figurent parmi les plus délicates à réaliser, il y a (fort heureusement) peu d’accidents grâce au suivi de procédures strictes et à l’entraînement et aux savoir-faire des équipages.
Cela n’empêche pas de continuer à travailler sur de nombreux domaines pour accroître :
• la conscience de la situation et la sécurité des équipages ;
• les performances des machines ;
• l’enveloppe opérationnelle du couple hélicoptère/navire ;
• rendre possible la qualification d’appareils autonomes.
Ces manœuvres, qui couvrent de nombreux domaines et nécessitent de résoudre plusieurs problématiques, offrent de formidables cas d’applications en matière de recherche, pour des usages en lien direct avec ces opérations (soufflage du sillage, aide au pilotage, etc…), ou des études plus amonts (méthodes numériques CFD, méthodes de synthèse de lois de contrôle, etc…)







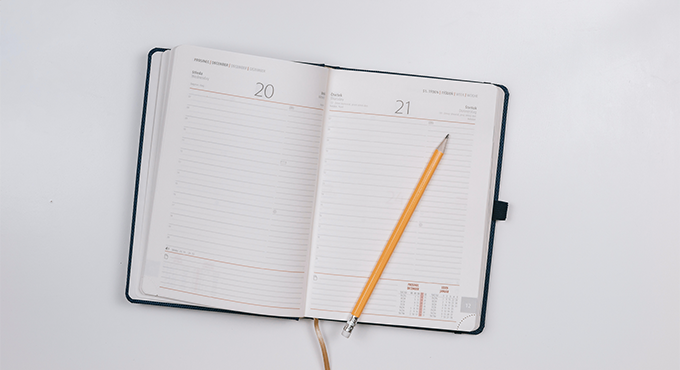

Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.